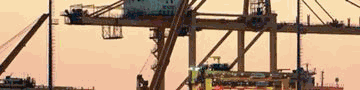Contribution : le coup d’état du 8/6/2003 est un événement qui « ne mérite ni éloge public ni condamnation automatique »
Mohamed Jemil Mansour ancien président du parti islamiste Tawassoul souligne que l’évaluation historique d’un putsch ne saurait se réduire à une dichotomie moraliste binaire. Son positionnement nuancé sur la tentative de renversement du régime de Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya le 8 juin 2003, portée par les « Chevaliers du Changement », demande à être élucidé.
Affirmer qu’un événement « ne mérite ni éloge public ni condamnation automatique », c’est poser un acte de pensée en rupture avec les réflexes moraux qui dominent l’arène politique post-événementielle. Ce que Jemil Mansour propose ici, ce n’est pas un simple relativisme, mais une épistémologie du contexte, c’est-à-dire une reconnaissance de l’opacité méthodique qui entoure encore le coup de 2003. Cette opacité n’est pas que mémorielle ou émotionnelle : elle est institutionnelle, archéologique, et partiellement verrouillée par les logiques de raison d’État.
En effet, tout jugement prématuré équivaudrait à ignorer l’infrastructure des loyautés latentes et des archives inaccessibles — autant de variables qui empêchent une lecture achevée. Ce que Mansour suggère, c’est que toute historiographie sérieuse de cette tentative exige non pas une grille idéologique, mais une méthodologie critique fondée sur l’exhumation des rapports de force, des dispositifs logistiques et des affiliations invisibles.
L’insistance de Mansour sur le caractère non-partisan de l’organisation des « Chevaliers du Changement » mérite également d’être analysée avec attention. En mettant en avant l’autonomie structurelle du groupe par rapport aux partis et mouvements existants, Mansour opère une distinction importante entre réseau d’action et système d’idéologie. Cela revient à dire que la tentative du 8 juin 2003 fut un projet politique sans enveloppe partisane formelle — une sorte d’acte de foi militaire fondé sur des alliances d’individus plutôt que sur des coalitions organiques.
L’usage du terme « indépendance » ici ne saurait être confondu avec neutralité : il désigne plutôt une logique de fragmentation du champ politique, dans laquelle les affiliations se jouent dans l’informel, le latent, l’affectif. Cette dimension rend le coup d’État de 2003 non réductible aux modèles classiques d’intervention militaire téléguidée par une mouvance politique.
Le diagnostic posé par Mansour — « mauvaise préparation » et « confusion dans l’exécution » — introduit une grille technocratique d’analyse du coup d’État. On quitte ici le terrain de la symbolique politique pour entrer dans celui de la planification opérationnelle. Un coup d’État, comme tout projet à fort contenu disruptif, repose sur trois axes : l’anticipation logistique, le calibrage de la surprise et la maîtrise du récit postérieur. Or, en 2003, ce triptyque semble avoir été partiellement absent ou mal articulé.
L’absence d’effet de cliquet et l’échec à créer une bascule narrative dans les premières 48 heures ont scellé le destin de l’opération. Ainsi, le putsch n’a pas échoué uniquement à cause d’un excès de bravoure ou d’un manque de ressources, mais parce qu’il n’a pas été conçu comme une opération totale — au sens gramscien du terme.
La thèse conclusive de Mansour — selon laquelle les coups d’État, même contre des régimes autoritaires, tendent à reproduire l’autoritarisme sous une autre forme — s’inscrit dans une tradition politique hobbesienne réinterprétée à l’aune des transitions africaines. La violence institutionnelle, même motivée par une quête de justice, n’accouche que très rarement de systèmes pluralistes. Elle crée, par effet de structure, un nouveau monopole de la force dont la légitimation dépend non plus du consensus mais de l’efficacité à maintenir l’ordre.
Mansour rappelle ici, implicitement, que le courage politique ne suffit pas — qu’il faut une architecture de transition, un projet de société, et une ingénierie de la légitimité pour que la rupture ne soit pas qu’un recyclage.
À travers son analyse, Mohamed Jemil Mansour ne désamorce pas l’importance historique du 8 juin 2003. Il en reconnaît la portée, mais refuse de l’enfermer dans une rhétorique héroïque ou moralisatrice.
Source : Mohamed Echriv Echriv