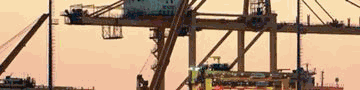Contribution : la mythologie du Cheval chez les Oulad Mbareck
Dans l’univers des Oulad M’bareck, l’histoire ne s’écrit pas, elle se joue. Et parfois, un simple pincement de corde bouleverse l’ordre du monde. C’est une mythologie vivante où le cheval, la tidinit et la parole scellée dessinent les contours d’une esthétique guerrière propre aux Oulad El Alya.
Le cheval chez les Oulad M’bareck n’est pas un animal : c’est un prolongement de l’orgueil tribal, une synthèse de lignage et de bravoure. Le sang qu’il charrie est celui des pur-sang arabes, lumineux, exigeant. Il ne mange pas du fourrage commun. Non. Ses naseaux ne tolèrent que la brume des dattes fraîches et la tiédeur du lait vivant.
La Mazouza, jument mythique, n’était pas simplement belle — elle était la beauté devenue mobile. On la disait capable de reconnaître les battements du cœur de son maître à plusieurs coudées, et d’interrompre sa course si le rythme s’enrayait. Plus qu’un destrier, elle était la métaphore d’un monde ordonné autour de la noblesse, du panache et du silence contenu.
Dans les sociétés guerrières du désert, il faut un métronome pour canaliser la rage. La tidinit, instrument des grands équilibres, joue ce rôle invisible mais vital : elle donne la cadence aux sabots, la respiration au combat, la poésie à la mort.
À l’approche des batailles, le griot frappait les marches des notes, non pour séduire, mais pour convoquer les esprits de la victoire. Le cheval, habitué aux tensions harmoniques, savait quand bondir, quand feinter, quand charger. Le guerrier, quant à lui, ne partait jamais sans avoir entendu Legetri — cette entrée tonale qu’on compare aux premières lueurs d’une aurore fatidique.
Là où l’État moderne aligne des manuels, le monde tribal aligne des gammes. Et dans ces gammes, il y a de la stratégie. Du pouvoir. Car la tidinit ne dit pas tout. Elle insinue. Elle suggère. Elle oriente les chevaux sans bride.
Quand la jument Mazouza devint l’enjeu d’une rivalité entre alliés d’hier, l’art fut préféré à l’assaut. Et qui de mieux que ʿAmmar Abily, créature hybride à la croisée des castes : guerrier, imam, poète, musicien des transitions, diplomate sans blason, griot sans corde désaccordée.
Déguisé en maître coranique, il infiltra le camp des Oulad M’bareck. Il s’attacha au chien comme au gardien, à coup de viande et de patience. Et lorsqu’il tenta de voler la jument Mazouza, le corps chutant, la dignité resta.
Mais c’est dans sa captivité que l’histoire bifurque vers le sublime :
Une tidinit posée là, sur Legetri, endormie comme une sentinelle.
Et ʿAmmar qui s’en empare, non pour se libérer, mais pour dire la vérité par les cordes.
« Yā nā hāh yā l‑méchawwach » —
une plainte, un poème, une confession.
Le prince Ely Cheikh Ould Henoune écoute. Le prince comprend. Le prince abdique devant l’art.
« Si tu avais joué cet air plus tôt, tu l’aurais obtenue sans peine. »
dit le prince en lui offrant non seulement la Mazouza, mais sa fille, et un passage sûr, comme on accorde un sauf-conduit aux mots bien chantés.
Les conseillers s’insurgent.
« Vous donnez la jument stratégique ? »
Et le prince, implacable comme la sagesse du désert :
« C’est la tidinit qui décide. »
La politique devient chant. La stratégie devient ritournelle.
L’honneur se mesure non en terrain conquis, mais en vibration entendue.
Sur la route du retour, alors que la victoire est acquise, ʿAmmar s’arrête. Les juments paissent. Le cœur, lui, médite.
Peut-on partir quand la beauté vous regarde encore ?
Peut-on abandonner un prince qui vous a pardonné en musique ?
Il revient. Par choix. Par noblesse. Par fidélité au geste.
Et le prince, dans une phrase que seuls les sages savent prononcer :
« Dans la discrétion du don, on ne garantit rien. »
Ce que l’on donne sans attendre, n’est pas perte. C’est apothéose.
Il y a des royaumes faits de cavaliers.
Il y a des royaumes faits de lois.
Mais le plus vaste de tous est fait de notes.
Et dans ce royaume, la tidinit est reine, la jument est allégorie, et l’artiste est maître.
C’est ce que la mythologie hassanienne murmure aux intelligences patientes :
le pouvoir ultime, ce n’est pas de prendre… c’est d’être digne d’être offert.
Source : Mohamed Echriv Echriv