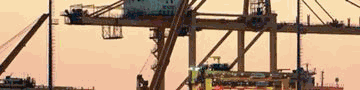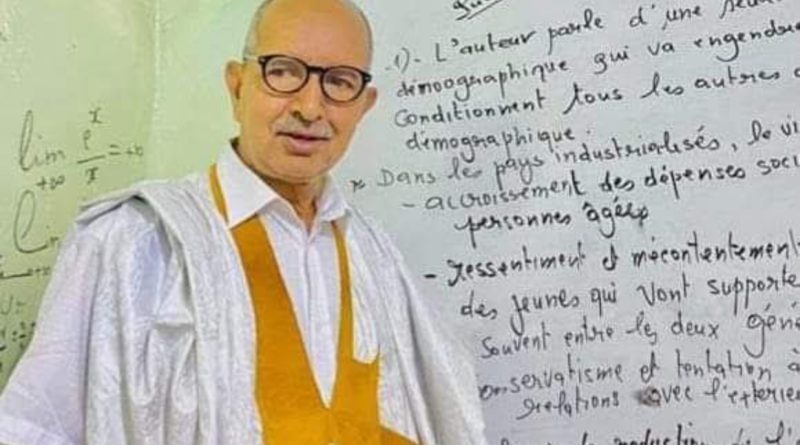Poly-Hong Dong : ou l’art délicat de pêcher dans les eaux troubles
Poly-Hong Dong : ou l’art délicat de pêcher dans les eaux troubles ,
Il y a des accords qui, lorsqu’ils sont signés, font couler plus d’encre que de poisson. L’exemple de Poly Hong Dong, entreprise chinoise de pêche pelagique, illustre à merveille cette diplomatie du filet lancé à longue portée, où la Mauritanie, en bonne élève du Sud Global, tend l’autre joue tout en offrant l’océan.
Depuis le 7 juin 2010, date bénie d’un investissement de cent millions de dollars américains (ce qui, soit dit en passant, représente aujourd’hui à peine quelques gratte-ciel shanghaïens), les eaux mauritaniennes dansent sous pavillon étranger. En contrepartie ? Un quai, une usine, des promesses de développement local… et un droit de pêche de 25 ans, à volonté. Autrement dit : « servez-vous, c’est ouvert ».
Ce que d’aucuns notamment « des porte-parole du pouvoir au détriment de la collectivité » qualifieraient de partenariat stratégique, d’autres un brin plus lucides l’appelleraient don gracieux de souveraineté halieutique. Car à défaut d’un transfert de technologie ou de compétences, nous avons surtout assisté à un transfert de poissons. Et de silence.
Le silence, justement, était assourdissant lors des cérémonies récentes célébrant les soixante ans de relations sino-mauritaniennes. Des discours feutrés, des compliments tressés comme des filets de soie, mais aucun mot, pas même une virgule, sur l’impact écologique ou social de cette grande amitié. Aucun haut cadre n’a osé demander pourquoi les poissons partent mais les savoir-faire restent bloqués à la frontière.
On se serait cru dans une tragédie grecque, sauf qu’ici, les chœurs ne dénoncent pas l’injustice : ils l’applaudissent. Les journalistes chantent les louanges du président avec une telle ferveur qu’on croirait entendre des griots du XXIe siècle, en version PowerPoint. Quant aux hauts cadres, ils rivalisent de superlatifs pour vanter « la vision éclairée » de Son Excellence, dans une compétition aussi prévisible qu’un lever de soleil à l’Est.
Car dans cette république du compliment perpétuel, critiquer équivaut à une tentative de suicide administratif. L’intellectuel qui, hier encore, fustigeait les dérives des puissants à coups de phrases alambiquées, se fait aujourd’hui le chantre d’une diplomatie dont il ne comprend pas les clauses, mais dont il devine les opportunités promotionnelles.
Soyons justes : la Chine est un partenaire précieux. Un géant méthodique, pragmatique, qui bâtit, creuse, irrigue, connecte. Elle est capable du meilleur. Mais entre des mains incompétentes ou cupides, ce partenariat devient un piège en soie rouge. Il faudrait, pour équilibrer la balance, des Mauritaniens aussi rigoureux que les Chinois. Des patriotes éclairés, non des courtisans vissés à leur chaise. Des technocrates soucieux du long terme, non des bureaucrates obsédés par leur bulletin de salaire: des relais d’opinion servant le pouvoir au détriment du bien commun.
Il ne s’agit pas de refuser l’amitié chinoise. Il s’agit de la mériter. Et de ne pas la brader. Il s’agit de veiller à ce que les ressources ne fuient pas comme le sable entre les doigts, pendant que les cadres ministériels applaudissent, bouche bée, la dernière usine montée sans transfert de technologie.
Il est temps que les cadres mauritaniens cessent de se comporter en distributeurs automatiques de louanges: des voix alignées sur les intérêts du régime plutôt que ceux du peuple. Il est temps que nos intellectuels sortent du bois pas seulement pour publier des poèmes lyriques sur Facebook ou philosopher sur l’éthique depuis leurs balcons climatisés.
Ce pays a besoin d’une pensée lucide, courageuse, et d’une parole libre. Car à force de naviguer entre Washington, Pékin, Moscou et l’OTAN, la Mauritanie risque de devenir ce navire sans capitaine, dont les voiles claquent au vent mais dont la boussole est restée à terre.
Eléya Mohamed
( notes amères d’un vieux professeur)