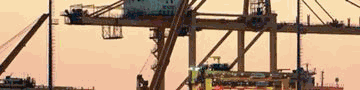Contribution : lors d’un débat relatif à la loi de Finance,un Député donne un coup de pattes et de Griffes soulevant un Débat inédit – Par Mohd Echriv
Lors de la séance sur la loi de finances rectificative, un jeune député de la majorité a rompu ce qu’il faut bien appeler un pacte tacite : celui qui lie confort personnel et silence collectif. Par quelques phrases sobres, il a soulevé une interrogation fondamentale que tout parlement devrait se poser avant chaque clôture de session : qu’avons-nous fait pour mériter l’argent du peuple ?
Dans un pays où l’essentiel du budget de l’État provient de ressources collectives raréfiées, chaque député a perçu cette session plus de 4,5 millions d’ouguiyas en rémunération directe. Et ce, hors indemnités, frais de mission, primes, billets d’avion en classe affaires, véhicules de fonction et autres traitements annexes — parfois difficilement quantifiables mais rigoureusement comptabilisés.
Ce chiffre, à lui seul, devrait suffire à imposer une introspection institutionnelle. Car derrière ce montant s’étend un paysage social où l’enseignant peine à se loger dignement, où l’agent contractuel travaille sans fiche budgétaire avec une solde retardée de deux moi. Face à cette réalité, que vaut le rendement parlementaire ?
Le député en question, sans crier, a énoncé une vérité simple : l’utilité d’un représentant ne se mesure ni à la qualité de son fauteuil, ni à la densité de ses indemnités, mais à la rigueur de son engagement, à sa présence dans l’hémicycle, à sa capacité à produire, discuter, amender, contrôler. Et c’est précisément là que le bât blesse.
Car que constate-t-on ? Un absentéisme persistant, y compris chez ceux qui résident à quelques minutes du Parlement. Des bancs vides durant les débats essentiels — notamment ceux relatifs à la loi de finances rectificative et à la loi de règlement, textes cardinaux dans toute architecture démocratique. Sur les 176 députés, seuls 32 étaient présents lors de la dernière séance sur la reddition des comptes. L’hémicycle ressemblait davantage à une salle d’attente désertée qu’à un forum républicain.
À cela s’ajoute une forme de légèreté institutionnelle devenue presque systémique. Il n’est pas rare de voir certains élus se déporter, en pleine session, vers d’autres horizons — parfois pour raisons personnelles, souvent sans justification publique. Pendant ce temps, la voix du peuple, censée trouver écho dans la parole parlementaire, se perd dans les couloirs numériques des réseaux sociaux, où les plus absents deviennent souvent les plus bruyants.
Il est de ces figures au verbe ardent, toujours promptes à s’ériger en sentinelles de la morale publique, qui n’hésitent pas à enflammer les foules et les réseaux… sauf quand il s’agit d’enflammer l’hémicycle. Pendant que la nation discute lois et budgets, certains préfèrent le calme des oasis aux turbulences du débat républicain. À Chinguetti, entre deux poignées de dattes Selmedina et quelques envolées spirituelles, on oublie parfois que le mandat parlementaire se joue d’abord dans la présence, pas dans l’éloquence différée. L’engagement ne se mesure pas à la fréquence des discours, mais à la constance des actes.
Pire encore, la représentation nationale, dans un silence presque chorégraphié, évite de s’interroger sur des avantages plus discrets mais non moins substantiels : dotations foncières à Tevragh-Zeina. Des opérations répétées, bénéficiant aussi bien aux députés de la majorité qu’à ceux de l’opposition, et qui n’ont donné lieu à aucun débat éthique sérieux. Là encore, le silence sert de consensus.
Et c’est précisément ce silence que ce jeune député a osé briser. Non pas par populisme. Non pas par calcul. Mais par fidélité à une idée exigeante du mandat parlementaire : celle qui oblige l’élu non à se servir, mais à servir.
Son intervention, n’a pas simplement dénoncé un excès. Elle a mis en lumière un désajustement structurel : entre ce que coûte l’Assemblée et ce qu’elle produit, entre ce qu’elle perçoit et ce qu’elle restitue, entre la République qu’elle prétend incarner et la réalité qu’elle laisse proliférer.
Il ne s’agit pas ici de stigmatiser une institution qui reste essentielle à la démocratie. Mais de rappeler que la légitimité politique n’est pas un acquis ; elle se reconquiert à chaque session, par le travail, l’exemplarité, la présence, la probité. Un mandat parlementaire n’est pas un privilège. C’est un contrat moral, révisable à tout instant par l’opinion publique.
Et s’il est un mérite à reconnaître à cette prise de parole isolée, c’est d’avoir réintroduit dans l’hémicycle cette formule trop souvent oubliée : rendre compte. Non pas dans un rapport final, ni devant un tribunal, mais devant une conscience collective qui s’impatiente. Une conscience qui commence à comprendre que, dans cette République, l’indignation la plus précieuse n’est plus celle qui s’affiche, mais celle qui agit.
Mohamed Echriv Echriv