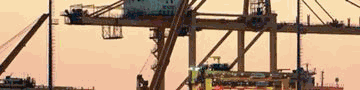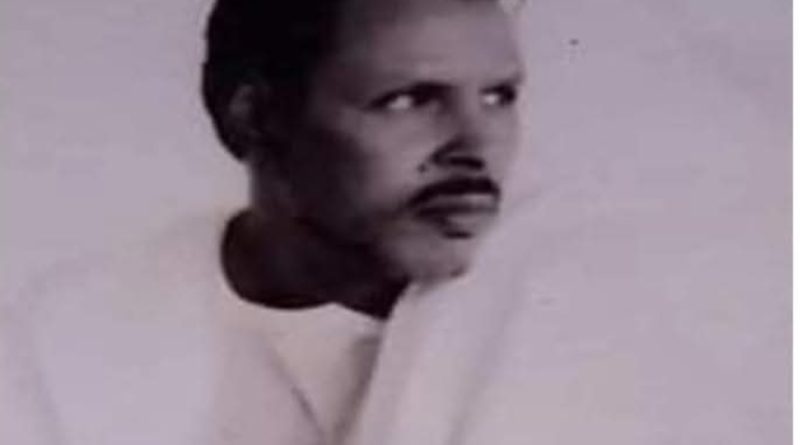Un pan d’histoire mis en exergue par Mohamed Ould Mouloud OULD Daddah à la Haye ce 9/7/1975
Il est des moments d’histoire où la parole seule, dépouillée d’apparat, armée de rigueur et de vérité. Le 9 juillet 1975, à La Haye, devant la Cour internationale de Justice, Mohamed Ould Maouloud Ould Daddah — savant polymathe, orientaliste hors pair, puits de science et de mémoire — fit de l’oralité diplomatique un art stratégique d’anéantissement pacifique. Ce jour-là, dans l’auguste salle d’audience, un homme fort de toute une civilisation, fit vaciller les prétentions d’un empire symbolique : le rêve marocain d’un royaume de Tanger au fleuve Sénégal.
1974 : la Mauritanie, encore jeune république, fait face aux feux croisés de deux géants diplomatiques : au sud, Léopold Sédar Senghor, poète-président à la voix douce mais à la plume acérée, insinue une ambition fluviale qui remet en cause la souveraineté historique sur les rives du fleuve Sénégal. À cette tentative, la réponse fut cinglante, polie, imparable : une lettre synthétisée par Mohamed Aly Chérif, chef-d’œuvre de diplomatie administrative et de logique géohistorique.
1975 : au nord, un autre voisin, cette fois monarchique, avance masqué derrière les oripeaux d’un passé impérial réinventé. Le Maroc, héritier d’un panarabisme territorialiste, brandit l’autorité spirituelle d’un saint homme — Cheikh Ma el Aïnin — pour tenter de territorialiser la mémoire, de cartographier le soufisme, et de justifier ainsi une marocanité fantasmée d’une partie du territoire mauritanien.
Mais voilà que la Mauritanie, aligne non pas des légions mais des lettrés. Et au front juridique, elle envoya l’un de ses plus illustres érudits : Mohamed Ould Maouloud Ould Daddah. L’homme n’est pas seulement historien, il est topographe des consciences, géographe des frontières mentales et spirituelles, archéologue du sens.
Ce qu’Ould Maouloud livra devant la Cour ne fut pas une simple plaidoirie. C’était une dissection scientifique d’un mythe politique. Son exposé orale, construit comme un récit de vérité, commence par un geste noble : ne pas attaquer, mais contextualiser. Il ne nie pas Cheikh Ma el Aïnin, il le restitue.
Au début de son exposé, Ould Maouloud désamorce toute tentative de polémique. Il affirme la nécessité d’un éclairage complémentaire, et non d’une joute idéologique. Il adopte une posture d’historien, pas de plaignant. Il annonce que sa source principale sera le Cheikh Ma el Aïnin lui-même, ses proches, ses écrits, ses manuscrits.
« Nos sources n’ont d’autre originalité que d’être de première main. »
Ici, il neutralise d’emblée toute critique de parti pris. La méthode est scientifique, neutre, rigoureuse. C’est la posture d’un épistémologue du désert.
Ould Maouloud commence par situer le Cheikh dans le Hodh mauritanien, sa tribu (les Glagma), son père (fondateur de la Fadeliyya une branche de la Qadiriyya), son parcours initial : Chinguetti, Adrar, Néma, Tiris. Il détaille les étapes de sa formation, ses maîtres, ses frères, ses premiers disciples. Il peint le marabout dans sa chair territoriale.
« Le Cheikh est né dans le campement paternel à Baribafa, au sud-ouest de Néma, en février 1831. »
C’est une cartographie de l’âme. Le Maroc, à ce stade, n’existe pas dans sa trajectoire.
Il démontre que pendant plus de 25 ans, le Cheikh agit en tant que guide spirituel autonome, dans un espace qui déborde les frontières coloniales : il imprime à Fès, voyage à La Mecque, passe par l’Algérie, l’Égypte, sans jamais s’affilier politiquement. Ce n’est qu’après 1860, et encore, dans des conditions précises, qu’il entre en contact avec le Sultan du Maroc.
« Il voulait faire imprimer ses écrits, pas rallier un trône. »
L’allégeance était éditoriale, pas étatique. C’est là que le génie narratif opère : il montre que le Maroc n’était qu’un passage logistique, non un centre d’obédience.
Il explique comment le Cheikh, face à la pénétration française, cherche un soutien musulman. Il écrit au Sultan, mais aussi à Istanbul, à Damas. Il tente de sauver l’Islam, pas d’annexer la Mauritanie au Maroc.
La thèse marocaine repose sur la symbolique religieuse, sur l’idée qu’une allégeance spirituelle impliquerait une intégration territoriale. Ould Maouloud détruit cette confusion en montrant que le soufisme mauritanien rayonne partout sans jamais effacer les souverainetés locales : Ni Saad Bouh ni Sid el Kheir — frères du Cheikh — n’ont jamais été marocains, bien qu’ils fussent aussi influents.
Au lieu de nier le Cheikh, Ould Maouloud le magnifie, l’exalte, l’insère dans la grande tradition mauritanienne, et le rend incompatible avec la thèse marocaine.
Ould Maouloud refuse la réduction du Sahara à une querelle de juridiction. Il y voit un espace de rencontre civilisationnelle, un carrefour d’érudition et de piété. Il affirme la souveraineté mauritanienne non par la guerre, mais par l’ancienneté des liens, la profondeur des savoirs, la continuité des institutions religieuses.
À La Haye, ce jour de juillet 1975, la Mauritanie ne se contenta pas de défendre son territoire : elle affirma son droit à l’histoire. Grâce à Mohamed Ould Maouloud Ould Daddah, elle fit entendre au monde que la mémoire est une science.
Mohamed Echriv Echriv
Ce jour-là, un homme seul a parlé au nom d’un peuple. Et ce fut suffisant.
Source : Mohamed Echriv Echriv