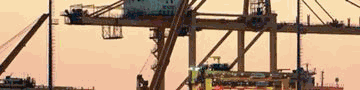Avec 309.000 réfugiés et demandeurs d’asile, la Mauritanie est l’un des pays africains les plus exposés en matière d’accueil
L-Post Media – La Mauritanie se trouve aujourd’hui au cœur des débats migratoires. Sa position géographique, entre Sahel et Maghreb, en fait à la fois une zone de transit et un pays d’accueil. Contrairement à l’image souvent véhiculée dans certains discours européens, elle ne se réduit pas à un « sas » de passage : elle assume une fonction humanitaire de premier plan. Selon le HCR, à la mi-2025, la Mauritanie accueillait environ 309.000 réfugiés et demandeurs d’asile, dont 177.000 enregistrés. Cela représente une augmentation de 75% en un an, l’essentiel venant du Mali, mais aussi de Syrie, de Côte d’Ivoire, de Centrafrique ou encore de Guinée. Les camps de réfugiés débordent, mais le pays tente d’intégrer les migrants. Il bénéficie de moyens financiers de l’extérieur, notamment de l’Union européenne. L’histoire de la Mauritanie explique en partie cette posture. Carrefour de routes caravanières, elle a toujours connu la coexistence de populations diverses (peules, soninkés, songhaï, wolofs, commerçants venus du Maghreb). Cette dimension plurielle a façonné une culture d’hospitalité inscrite dans la durée, et qui continue de s’exprimer dans les politiques publiques actuelles. Une réalité chiffrée : l’un des plus forts taux d’accueil en Afrique Selon le HCR, à la mi-2025, la Mauritanie accueillait environ 309.000 réfugiés et demandeurs d’asile, dont 177 000 enregistrés. Cela représente une augmentation de 75% en un an, l’essentiel venant du Mali, mais aussi de Syrie, de Côte d’Ivoire, de Centrafrique ou encore de Guinée. Rapporté à la population nationale, cet effort place la Mauritanie parmi les pays africains les plus exposés en matière d’accueil. Le camp de M’Béra, dans le Hodh Ech-Chargui, symbolise cette pression. Conçu pour 70 000 personnes, il en héberge aujourd’hui plus de 110.000, tandis que 150.000 réfugiés supplémentaires se sont installés dans les villages alentours, partageant ressources et services avec des communautés locales déjà vulnérables. Un cadre juridique solide, mais des moyens limités La Mauritanie est signataire des principaux instruments internationaux relatifs aux réfugiés – Convention de Genève de 1951, Protocole de 1967, Convention de l’OUA de 1969 – et a intégré le droit d’asile dans sa législation nationale. Les réfugiés ont progressivement accès à l’école publique, aux services de santé et aux registres sociaux. Toutefois, cette politique inclusive repose sur des financements extérieurs insuffisants. L’Union européenne a annoncé en 2024 un partenariat de 210 millions d’euros, mais ce montant reste en deçà des besoins réels. Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) connaît des difficultés récurrentes pour garantir des rations complètes, et les ONG alertent sur le déficit d’infrastructures et de services de base. Certains rapports évoquent des cas d’expulsions collectives ou de détentions arbitraires. Ces éléments doivent être pris en considération. Mais ils ne sauraient occulter l’effort structurel de la Mauritanie. Les autorités rappellent que les lieux de rétention sont accessibles aux organisations internationales, que des formations aux droits humains sont dispensées aux forces de sécurité et que des mécanismes de plainte existent. Un acteur clé sur le plan maritime La dimension maritime est souvent sous-estimée. En 2024, plus de 25.000 migrants arrivés aux Canaries avaient embarqué depuis les côtes mauritaniennes. La surveillance assurée par les garde-côtes, souvent en coopération avec l’Espagne, permet non seulement de limiter les réseaux de passeurs, mais aussi de sauver des vies. Les interceptions d’embarcations en détresse et la prise en charge de naufragés constituent un volet humanitaire essentiel de cette action. La Mauritanie illustre la contradiction d’un pays à la fois indispensable et insuffisamment soutenu. Elle assume un rôle humanitaire et sécuritaire qui dépasse largement ses capacités nationales, tout en restant fidèle à une tradition d’accueil. L’enjeu pour la communauté internationale est double : reconnaître la spécificité de ce modèle, et surtout le financer à hauteur des besoins. Sans cet appui, la stabilité de la Mauritanie – et par ricochet celle de la région – pourrait être compromise.
Paul Villerac
Economiste français