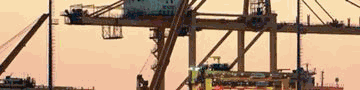Gouverner, ce n’est pas courir après les événements ; c’est les précéder. L’eau !
Il est des crises qui se contentent d’être gérées, et d’autres qui sculptent, dans le marbre de l’opinion, une image indélébile du pouvoir. Celle que traverse aujourd’hui Nouakchott — pas une goutte d’eau — appartient à cette seconde catégorie. Car même si la pénurie venait à être résorbée dans les prochains jours, la cicatrice, elle, restera. Elle restera dans la mémoire nationale comme dans le regard, souvent sévère, de l’opinion internationale.
Le problème n’est pas seulement technique : il est systémique. Dans cette république aux ressources humaines abondantes mais souvent mal employées, on attend la crise pour réagir. Or, gouverner n’est pas éteindre l’incendie après l’embrasement ; gouverner, c’est construire des digues invisibles avant que ne survienne la crue.
Mohamed Saleck Ould Heyine ancien directeur de la SNIM, homme de terrain et de bon sens, résumait la philosophie de la bonne gestion en une phrase lapidaire : « Gérer, c’est gagner quand le prix du fer est bas ». Autrement dit, c’est dans l’adversité que se mesure l’art de diriger, non dans l’abondance. Ce principe simple, la machine administrative mauritanienne semble l’avoir oublié. On nomme un administrateur de régies à la tête de la SOMIR, comme si l’industrie du raffinage se gouvernait avec un sac à dos de fonctionnaire. On place un docteur en économie à la tête de l’Entreprise d’Entretien Routier, comme si la maîtrise des comptes se substituait à la science des matériaux et à l’art du bitume. On confie Mauritania Airlines à un inspecteur des impôts, et l’on s’étonne que le ciel se couvre d’orages administratifs…
Et pourtant, l’exemple existe. Le projet Aftout Essahli, ce chantier titanesque qui a changé le destin hydraulique du pays, fut conduit avec une efficacité rare par une équipe d’ingénieurs aguerris, sous la houlette de Sidi Ould Mohamed Lemine Ould Biha. Formé à l’École Centrale de Paris, reconnu pour sa compétence et son intégrité, cet homme de terrain a également supervisé la construction du Débourbeur de Beni Naaji, chef-d’œuvre technique visant à dompter la turbidité des eaux. Aujourd’hui, il a été relégué dans un garage institutionnel, occupant le poste de conseiller en hydraulique et assainissement au cabinet de la ministre. Et l’on peut penser que, s’il avait été maintenu sur le terrain, nous n’en serions peut-être pas arrivés à cette crise.
Quant à la ministre elle-même, jeune, énergique, et consciente de l’urgence, elle affirme que son département travaille d’arrache-pied pour éradiquer le problème, aggravé cette année par une turbidité inédite. Acheminement maritime d’équipements lourds, installation surveillée comme une opération chirurgicale, mise en service de deux des six unités de production : les gestes sont là, les résultats commencent à se faire sentir. Elle promet que la crise touchera bientôt à sa fin.
Mais au-delà des chiffres et des tuyaux, reste la question centrale : pourquoi faut-il que la soif devienne insoutenable pour que l’action soit déclenchée ? L’histoire retiendra peut-être que cette crise fut résolue, mais elle retiendra surtout qu’elle n’aurait pas dû éclater. Gouverner, ce n’est pas courir après les événements ; c’est les précéder. Et tant que la République confondra réagir avec prévoir, elle se condamnera à voir ses crises transformées en miroirs impitoyables, reflétant moins la pénurie d’eau que celle de vision.
Mohamed Echriv Echriv