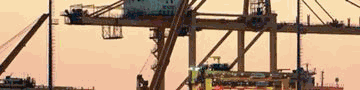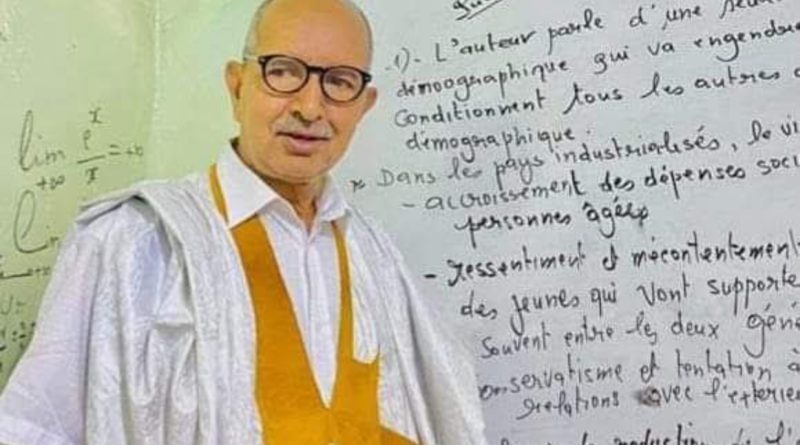L’arabité : un héritage stérile et source de dépendance – Par Mohamed Eleya
L’arabité : un héritage stérile et source de dépendance
Depuis plusieurs décennies, la Mauritanie s’est engagée dans un processus d’arabisation culturelle et linguistique, censé affirmer son appartenance à l’ensemble arabo-islamique. Toutefois, en dépit des nobles ambitions affichées, force est de constater que cette orientation n’a nullement abouti à une renaissance culturelle authentique ni à l’affirmation souveraine de notre identité. Bien au contraire, cette arabité – souvent imposée d’en haut – s’est révélée un moule stérile, incapable de porter les aspirations profondes du peuple mauritanien ou de féconder une pensée novatrice et libératrice.
D’une part, il est indéniable que la langue arabe recèle une richesse lexicale, poétique et philosophique remarquable. Porteuse d’un immense legs civilisationnel, elle fut historiquement un vecteur d’érudition, de raffinement littéraire et de spiritualité. Pourtant, en Mauritanie, cette langue n’a point été intégrée de manière organique et créative ; elle fut plaquée comme un signe d’orthodoxie et d’adhésion idéologique. Instrumentalisée non comme levier d’émancipation, mais comme outil de conformité, elle sert un modèle exogène.
De surcroît, cette arabité n’a suscité chez nous aucune révolution intellectuelle. Elle n’a décloisonné ni les esprits, ni libéré la parole, ni inspiré de dynamique progressiste. Enfermée dans les schémas d’un héritage figé et sclérosé, elle s’est montrée incapable de renouvellement. Pire, elle nous a condamnés à une dépendance culturelle et psychologique envers des pays dits arabes – dont les systèmes politiques incarnent majoritairement l’échec. Nations riches en ressources, en capital humain et en histoire, elles demeurent otages d’un despotisme archaïque, d’une tyrannie subtilement sacralisée et d’un culte du chef profondément enraciné. Il en résulte une soumission aux caprices des puissances étrangères et une vaine quête de reconnaissance occidentale, quand bien même leurs peuples les rejettent.
Ce mimétisme politique n’est point sans conséquences sur notre trajectoire nationale. Trop de nos dirigeants ont puisé leur inspiration dans ces régimes autoritaires où le pluralisme est réprimé, la liberté de pensée étouffée, et toute critique assimilée à une trahison. Le résultat est sans appel : vie intellectuelle appauvrie, jeunesse désorientée, débat public atrophié, société figée entre un passé idéalisé et un avenir incertain – identité en contradiction flagrante avec le vécu quotidien.
L’article de Georges Voisset sur la littérature mauritanienne souligne à juste titre cette complexité identitaire : arabe par la culture, la langue et la religion ; africaine par son ancrage géographique et sa mosaïque ethnique. Cette dualité imprègne les productions littéraires : langues employées, thèmes abordés, formes stylistiques varient selon les appartenances communautaires. Le débat latent entre langue nationale (arabe ou hassaniyya) et langues africaines (pulaar, soninké, wolof) révèle crûment les tensions identitaires traversant le pays. S’y ajoute la question structurelle des Haratines, mal contenue par des politiques inadaptées aux réalités socioéconomiques.
Or, rappelons-nous : même lors de la conquête de l’Andalousie, les Mourabitounes ne surent tirer profit de la civilisation arabo-andalouse qui s’offrait à eux. Enfermés dans un repli dogmatique et une fermeture à l’altérité, ils manquèrent l’opportunité historique de s’abreuver aux savoirs, aux arts et à l’ouverture d’esprit de Cordoue et Grenade. Comme je l’ai déjà souligné, cette incapacité à accueillir la différence et dialoguer avec d’autres cultures entrave depuis lors notre évolution. La pensée d’Albert Jacquard résonne ici avec force : « Quel plus beau cadeau l’autre peut-il nous faire que de renforcer notre originalité en étant différent de nous ? »
Ainsi, le refus de la diversité – érigé en vertu – constitue l’un des principaux facteurs de notre stagnation culturelle. L’arabe tel que pratiqué chez nous ne dialogue point ; il s’impose. Il ne s’enrichit pas au contact de l’autre ; il s’en défend. Cette conception figée de l’arabité nous rend tributaires de peuples en crise, alors que nous aurions pu édifier un modèle singulier, fondé sur l’ouverture, la pluralité et la cohabitation des héritages.
Il ne s’agit aucunement de rejeter l’arabe comme langue ou culture, mais d’en dénoncer l’instrumentalisation en outil d’exclusion et d’hégémonie. Une langue n’est féconde que lorsqu’elle devient vecteur de liberté, d’invention et de pluralité. Or, l’arabe imposé en Mauritanie obéit à une logique inverse : normalisation, contrôle, soumission à un ordre idéologique étranger à notre réalité historique.
En définitive, il devient urgent de repenser notre rapport à l’arabité. Non par son rejet, mais par son intégration dans un cadre plus vaste et inclusif – où l’africanité ne serait plus occultée ni subordonnée, mais reconnue comme fondement de notre être collectif. Seule cette refondation nous permettra de forger une culture nationale authentique : affranchie des modèles autoritaires, ouverte sur le monde, et fidèle à la diversité profonde de notre peuple.
Eléya Mohamed
(Notes amères d’un vieux professeur )