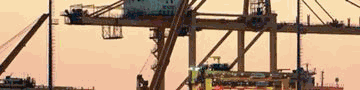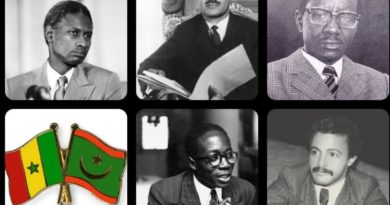Conflit du Sahara : les ressorts de la stratégie symbolique du Maroc
Le conflit du Sahara oppose le Maroc aux indépendantistes du Front Polisario, soutenus par l’Algérie, autour du statut de ce vaste territoire désertique. Rabat revendique sa souveraineté sur cette région, tandis que le Polisario milite pour l’indépendance de la « République arabe sahraouie démocratique ». Ce différend, hérité de la décolonisation espagnole, cristallise des rivalités géopolitiques régionales.
La question du Sahara – territoire qui s’étend du Sud du Maroc jusqu’à la frontière mauritanienne – met en évidence les limites du réalisme classique face aux nouvelles dynamiques de politique étrangère. Le néoréalisme est une doctrine des relations internationales qui ajoute une dimension structurelle au réalisme de la politique étrangère en y greffant d’autres éléments en dehors des considérations classiques comme la puissance ou la sécurité. Une nouvelle étude démontre en effet que ce conflit ne relève plus seulement d’enjeux de puissance ou de sécurité. Il engage des dimensions identitaires, historiques et symboliques. Le néoréalisme permet d’éclairer la stratégie marocaine, dans ce conflit, comme une diplomatie de projection intégrant développement et influence régionale.
L’universitaire Azeddine Hannoun, auteur de l’étude, explique à The Conversation Africa comment cette stratégie fonctionne.
Comment la question du Sahara illustre-t-elle les limites du réalisme classique ?
La question du Sahara met en lumière les limites du réalisme classique dans sa capacité à appréhender la complexité des dynamiques actuelles de politique étrangère au sens large. Le réalisme traditionnel postule que les États agissent de manière rationnelle pour maximiser leur puissance dans un environnement anarchique, en poursuivant leurs intérêts nationaux définis essentiellement par la sécurité.
Or, dans le cas marocain, cette vision est réductrice. Le Sahara ne se réduit plus à une question de puissance ou de sécurité : il est aussi un vecteur identitaire, historique, et civilisationnel. Dans mon article, je montre que le réalisme classique ne permet pas de saisir la dimension immatérielle et symbolique de la question saharienne, notamment le rôle du lien d’allégeance (Beia), la centralité de la souveraineté, et le lien entre légitimation interne et positionnement externe.
C’est là qu’intervient le néoréalisme, évoqué dans l’article : un réalisme repensé, davantage tourné vers la structure du système international et les contraintes géopolitiques, mais qui cherche également à intégrer des objectifs économiques et de rayonnement stratégique, en rupture avec la vision axée uniquement sur la sécurité du réalisme classique. Ce néoréalisme permet au Maroc de dépasser une diplomatie de réaction pour adopter une diplomatie de projection.
J’ai évoqué, dans l’article, la question de la transformation fonctionnelle du bloc réaliste de la politique étrangère marocaine à travers un équilibre voire une complémentarité trouvée et entretenue entre le prisme de la question du Sahara en l’intégrant dans d’autres objectifs à caractère stratégique.
En effet, la priorisation de la question du Sahara et de l’intégrité territoriale de manière générale consistait dans une orientation remettant en seconde zone toutes les autres dimensions. Ainsi, la sortie du Maroc de l’OUA en était un témoin. La politique de la chaise vide consistait dans la dogmatisation de la politique étrangère. Or, depuis quelques années la nouvelle politique africaine du Maroc consistait à pénétrer mêmes les pays classés comme des soutiens du Polisario comme l’Ethiopie ou le Nigéria…
The conversation com