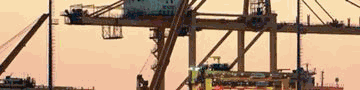La vraie question est : le pouvoir actuel saura-t-il lire les phénomènes muets, entendre les attentes profondes, répondre à l’urgence de justice et d’intégrité ?
Mohamed Yehdhih Ould Breideleil, visionnaire dont l’écriture, trempée dans l’encre des réalités les plus hermétiques, ne parlait pas aux foules mais aux esprits capables de lire derrière l’opacité des faits. Lorsqu’il évoquait le bilan politique comme un assemblage de « phénomènes muets », il ne cherchait pas l’effet de style. Il signalait, au contraire, l’exigence première de la politique : la capacité à traduire l’indicible, à transformer le chaos en intelligibilité.
Le moment actuel, marqué par l’appel au dialogue et le quasi-consensus des forces politiques, n’est pas une banalité démocratique mais une anomalie créatrice. Breideleil, s’il était encore parmi nous, aurait insisté : le consensus ne survient jamais par hasard. Il surgit lorsqu’un enjeu vital, presque existentiel, se présente à une société. Ainsi, à l’époque de Moktar Ould Daddah, la nationalisation de la MIFERMA n’était pas une simple décision économique : elle était le geste fondateur d’une souveraineté assumée. L’unanimité de circonstance qui suivit n’était pas le signe d’une paix superficielle, mais l’expression d’un désir collectif qui trouva soudain sa traduction dans l’acte d’un leader.
À l’inverse, lorsque Maaouiya Ould Taya introduisit le pluralisme, ce n’était pas une vision mais une concession tactique, vite minée par la corruption et le clientélisme. Ce faux consensus ne produisit que des fractures durables. Breideleil nous aurait rappelé que le consensus authentique ne peut naître que de l’audace visionnaire, jamais de la ruse conservatrice.
Un bilan économique se calcule, un bilan politique se déchiffre. La comparaison des comptes publics ou des performances budgétaires appartient au domaine du visible. Mais la politique véritable opère dans l’invisible : le degré de confiance du peuple, le sentiment de justice, l’espérance suscitée ou déçue. Ici réside la pertinence des « phénomènes muets » : ils n’adressent leurs messages qu’à ceux qui savent écouter.
Aujourd’hui, la lecture des signes est sans équivoque : le peuple veut un changement radical. Pas seulement une rotation des élites mais une révolution qualitative — des cadres intègres, des ministres compétents et charismatiques, un État qui assume la reddition des comptes. L’obsession du maintien au pouvoir ne peut plus faire illusion ; elle est désormais un signe de faiblesse et non de force.
Breideleil nous aurait avertis : aucun pays ne se construit dans l’oisiveté. Le peuple doit revenir à l’intérieur du pays, non pas dans le sens géographique, mais dans le sens organique du terme : retourner à la terre, à la production, au travail manuel, à la lecture qui élève l’esprit. Car une société qui délègue tout à l’État sans produire elle-même se condamne à la dépendance et à la frustration.
La jeunesse doit être replacée au centre de ce projet. Non pas en spectatrice d’un théâtre politique qui se répète, mais en actrice d’un redressement à la fois moral et productif. Le véritable changement structurel naît de cette jonction : l’énergie créative de la jeunesse et la responsabilité d’un État qui sait orienter sans étouffer.
Chaque époque choisit son défi. Celui qui le saisit s’élève, celui qui l’ignore s’effondre. Après une année du second mandat présidentiel, la question n’est pas seulement d’évaluer des ministres ou de sanctionner leur lenteur. La vraie question est : le pouvoir actuel saura-t-il lire les phénomènes muets, entendre les attentes profondes, répondre à l’urgence de justice et d’intégrité ?
Car, au fond, la politique n’est pas l’art de gérer mais l’art de lire. Breideleil, ce visionnaire, nous l’avait appris : dans la pénombre des bilans et le vacarme des discours, il faut toujours chercher l’encre invisible qui dessine l’avenir.
Mohamed Echriv Echriv