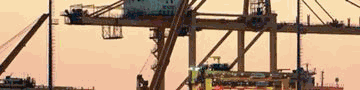La Mauritanie appartient à tous ses citoyens, Pulaar, Soninké, Wolof, Maures blancs et noirs
XXᵉ siècle a connu un théâtre où le racisme n’était pas une rumeur mais une infrastructure. Aux États-Unis, les lois Jim Crow, les pancartes « White Only », les universités refusant les Noirs malgré les arrêts fédéraux. Même la musique séparait : Gospel et Blues pour les Noirs, Country et Folk pour les Blancs.
De ce gouffre surgirent Malcolm X et Martin Luther King. Le premier, radical et tranchant, prônait une dignité conquise par la force ; le second, charismatique, lança son Dream . Mais l’exclusion demeurait.
En parallèle, dans le monde francophone, Aimé Césaire et Frantz Fanon expliquaient que l’aliénation coloniale n’était qu’un autre visage du même mal. La Négritude fut la réinvention d’un sujet noir universel. Fanon, avec Les Damnés de la terre, affirma que la violence anticoloniale était parfois la seule réponse au racisme systémique.
Dans ce contexte global, Moktar Ould Daddah hérita d’une Mauritanie éclatée, où les tribus, plus solides que l’État, étaient des univers complets : chefs, marabouts, tributaires, affranchis, esclaves. Gouverner revenait à neutraliser l’explosif tribal pour forger une citoyenneté commune. Avocat de formation, disciple du maître Boissier Palun, Moktar usa de sa vision pour bâtir un État reconnu dans le concert des Nations, sans jamais prétendre en être l’architecte solitaire.
A cette époque le Lycée National de Nouakchott été un creuset du savoir, animé par des professeurs éminents en sciences sociales qui, chacun à leur manière, ont contribué à forger les générations de l’après-indépendance. Parmi eux, Francis de Chassey, brillant professeur de philosophie, qui enseigna dans ce haut lieu de l’éducation mauritanienne. Dans son ouvrage Mauritanie 1900-1975, il décrivait la société comme un ensemble diversifié, réunissant Maures, Négro-Africains – Peuls, Wolofs, Toucouleurs et Soninkés – mais sans jamais mentionner le concept de « Haratines ». À ses yeux, il s’agissait plutôt de classes sociales en formation et en mutation. De son côté, l’éminent professeur d’éducation civique Mohamed Aly Chérif, également au Lycée National et inamovible secrétaire général de la Présidence sous le régime de Moktar, soulignait dans son ouvrage regards du sud que les groupes marginalisés de l’époque ne se définissaient pas par la catégorie. Il rappelait que le président Moktar Ould Daddah avait accordé à certains d’entre eux une priorité dans les nominations administratives afin de favoriser leur intégration, mais qu’ils demeuraient encore peu nombreux.
En réalité, le concept de « Haratines » ne trouve pas son origine dans le contexte mauritanien. Il fut importé du sud algérien par le gouverneur de l’Algérie Charles Jonnart, qui l’introduisit dans l’appareil administratif colonial et le transmit à Xavier Coppolani, alors gouverneur de la Mauritanie. Historiquement, ce terme arabe est attesté dès le Moyen Âge dans le Maghreb saharien, où il désignait des communautés d’affranchis et de cultivateurs noirs progressivement arabisés.
Le premier véritable exercice de confrontation aux tensions identitaires en Mauritanie remonte au « Manifeste des 19 » de 1966, signé par des intellectuels négro-mauritaniens, parmi lesquels figurait l’une des personnalités les plus marquantes de l’époque, le professeur Elimane Kane, originaire du Toro Ouest. Dans ce texte, les signataires exprimaient leur opposition à la décision jugée précipitée du président Moktar Ould Daddah d’imposer l’arabe comme langue obligatoire dans l’enseignement primaire et secondaire. Ils affirmaient s’engager dans la lutte pour « détruire toute tentative d’oppression culturelle » et « barrer la route à une arabisation à outrance ».
Moktar, habile stratège, tenta ensuite de rectifier cette décision afin d’apaiser les tensions. Ainsi, à la veille du coup d’État de 1978, les rapports entre les différentes composantes ethniques du pays ne connaissaient pas de fracture majeure. Certes, l’État était affaibli par la guerre du Sahara, mais il n’existait pas encore de véritable crise identitaire.
Ce constat remet en cause une théorie répandue parmi certains anthropologues, selon laquelle les conflits identitaires n’émergent que dans les périodes de fragilité de l’État.
C’est dans ce contexte, à la fin des années 1970, que Birame fit ses premiers pas. Né aux alentours de 1965 à Jedr El-Mohguen, près de Rosso, il grandit dans un milieu rural marqué par la coexistence des Pulaar, Wolofs, Soninkés et Maures, véritable carrefour culturel. En 1979, Birame entre au collège de Rosso. Il apprend quelques rudiments de Pulaar et de Wolof pour interagir avec ses camarades, ce qui lui permet de s’ouvrir à d’autres cercles. Mais déjà, son tempérament clivant lui attire des inimitiés. Rosso est alors un foyer bouillonnant de politisation, marqué par les échos de la négritude, les discours panafricanistes, mais aussi par l’influence des cadres du panarabisme et des syndicats.
Cette période charnière coïncida avec la création du mouvement El Hor, fondé le 5 mars 1978 pour lutter en faveur de la libération des esclaves. Parmi ses dirigeants, certains n’avaient eux-mêmes jamais connu l’esclavage, et l’un des fondateurs possédait même encore ses propres esclaves. Dès ses débuts, El Hor formula des revendications en faveur des droits des anciens esclaves affranchis. Le mouvement compta dans ses rangs des personnalités éminentes telles que Messaoud Ould Boulkheïr, Sghaïr Ould M’Bareck et Boïdiel Ould Houmeid. Pour eux, la question de la couleur de peau n’était pas centrale : leur conviction était que le « beydane » relevait d’une culture et non d’une couleur. Ils commencèrent à utiliser le terme Haratines mais considéraient les Haratines comme des composantes indissociables de leurs tribus – maures, halpulaar ou soninké – et revendiquaient pour eux les mêmes droits et devoirs que ceux reconnus aux autres communautés du pays.
Trop jeune pour s’imposer au sein d’El Hor, Birame tenta de contourner ce mouvement. En 1982, avec d’autres jeunes noirs de sa génération, il créa le Mouvement National Africain, centré sur la lutte contre l’esclavage et la discrimination. Ses militants effectuaient des tournées dans les villages pour sensibiliser les « Adwaba ». Mais cette initiative, manquant de poids politique, ne put rivaliser avec El Hor.
En 1984, Birame obtint son baccalauréat série A et fut orienté vers l’Université de Nouakchott. Deux ans plus tard, en 1986, il réussit le concours de recrutement des greffiers auxiliaires et fut affecté d’abord à Nouakchott.
L’année 1986 fut aussi celle des premières élections municipales pluralistes en Mauritanie. À Jedr El-Mohguen, la « vieille garde » désigna le chef général des Zembotti, Dina, comme candidat. Pour Birame, Dina représentait la « féodalité haratine locale », et il souhaita s’opposer à lui. Mais dans la sixième région, Dina demeurait une figure intouchable.
Birame fut ensuite muté comme greffier à Néma, ville où toutes les communautés vivaient en relative symbiose. Son discours y trouva peu d’écho. Ce n’est qu’à Nouadhibou, cité de pêcheurs, qu’il tenta d’introduire un discours plus clivant, aux accents divisionnistes. Toutefois, l’Inspecteur Diop Mohameden, lucide face à cette stratégie, parvint à étouffer l’initiative dans l’œuf.
Birame fut rappelé par son ministère de tutelle, la Justice, car un fonctionnaire public se doit de respecter une éthique professionnelle stricte. À l’époque, le secrétaire général du ministère, Sow Adama, grand connaisseur de l’arabe, le recadra fermement en lui donnant une véritable leçon d’éthique. Birame regagna ensuite son poste à Nouadhibou.
Avec l’avènement de la démocratie et de la nouvelle Constitution, Birame revint vers sa tribu maure des Oulad Ebyeri, fraction des Idaders. Il entra en contact avec Ahmed Ould Mennih, ministre de l’Intérieur sous Maaouiya Ould Sid’Ahmed Taya. Ce dernier, dans sa stratégie de contrôle local, s’appuyait sur des relais tribaux : à Boutilimit, son représentant attitré était précisément Ahmed Ould Mennih. Celui-ci comprit très vite que Birame n’était pas en mesure, à cette époque, de jouer un rôle politique d’envergure.
Birame rejoignit ensuite le RFD d’Ahmed Ould Daddah, mais peina à s’imposer face aux grandes figures qui entouraient le leader de l’opposition. Il quitta l’UFD en 1993 et se lança dans une candidature indépendante aux municipales de Nouadhibou, la deuxième ville du pays. Mais il n’y récolta même pas 200 voix.
Après cet échec électoral, il traversa le désert et entra en contact avec Cheyakh Ould Ely, chef des Joumans de l’Est, proche de ses oncles maternels par sa mère Mate Mint Bany. Les discussions n’aboutirent pas. Plus tard, il rencontra Messaoud Ould Boulkheïr, leader incontesté du mouvement El Hor, dont il admira le style politique. Mais Messaoud le jugea « peu politique » et déclara qu’il ne pouvait pas militer dans le même parti que lui. Déçu, Birame se rapprocha de nouveau d’Ahmed Ould Mennih et finit par intégrer le PRDS de Maaouiya, choix perçu par ses amis comme une trahison, car Taya était considéré comme hostile aux revendications ethniques.
Lorsque Messaoud créa ensuite le parti Action pour le Changement (AC), Birame y adhéra, puis se replia vers l’APP (Alliance Populaire Progressiste) après la dissolution de l’AC en 2000. Toutefois, dans ce parti aussi, il ne parvint pas à émerger : les rangs étaient dominés par des personnalités plus chevronnées, telles que Achour Ould Semba, Achour Ould Demba, Oumar Ould Yalli, qui contrôlaient la ligne politique de l’APP, dans une dynamique de rapprochement avec le nasserisme panarabe.
En parallèle, Birame entra en contact avec Boubacar Ould Messaoud, président de SOS Esclaves, intellectuel respecté et militant patriote. Ancien directeur général de la SOCOGIM, Boubacar avait été limogé avec fracas en 1991 après avoir dénoncé publiquement les violations des droits humains lors d’une conférence à Dakar. Birame rejoignit SOS Esclaves en 2002, mais en secret, et ne rendit son adhésion publique qu’après le coup d’État de 2005.
En 2006, il tenta à nouveau de s’imposer au sein de l’APP, sans succès. Il fut exclu des listes de campagne de Messaoud aux présidentielles de 2007, ce qui le poussa à quitter le parti. Il se rapprocha alors de Zeine Ould Zeidane, économiste candidat sans parti, qu’il rejoignit dans sa campagne. Mais lorsque Zeine, après sa défaite, rallia la majorité au pouvoir et obtint en contrepartie le poste de Premier ministre, il laissa Birame sans la place promise dans la haute administration. La rupture entre les deux fut définitive.
En 2008, Birame créa sa propre organisation : l’Initiative pour la Résurgence du mouvement Abolitionniste (IRA). Contrairement à SOS Esclaves, qui considérait la question de l’esclavage comme une survivance marginale, Birame remit ce thème au centre du débat politique, en exagérant certains cas isolés pour alerter l’opinion internationale. Cette posture lui ouvrit les portes d’ONG occidentales et des réseaux proches du Parti Radical européen.
Aziz, maître incontesté du pays et président en quête permanente de mise en scène, entra en contact avec Birame par l’intermédiaire de son ami Ahmedou Ould Moeid, ancien maire de Médérdra. La mission accomplie, ce dernier poursuivit sa carrière à Niamey comme comptable auprès du diplomate chevronné Abdellahi Ould Kebed. Aziz vit alors en Birame l’homme idéal pour ses projets de déstabilisation de la scène politique et pour tisser un rapprochement opportuniste avec certains progressistes de la vallée. Birame devint une figure médiatique, il l’emprisonna, puis le libéra afin qu’il puisse se présenter à la présidentielle de juin 2014. Lors de cette élection, Birame chercha à capitaliser sur sa proximité avec les progressistes de la vallée, avec plusieurs intellectuels de renom et une diaspora influente séduite par son discours.
En 2019, il se présenta à nouveau, mais commit un faux pas en rendant visite à Mohamed Yehdhih Ould Breidleil, idéologue baathiste associé par quelques cadres négros africains aux tragiques événements de 1987. Birame conclu un pacte avec Ould Breideleil, dans le maison de se dernier au Ksar, et Ould Breideleil apporta son soutien au programme présidentiel de Birame. Ce rapprochement avec les baathistes fit reculer une partie des progressistes négro-africains.
Par la suite, Birame tenta de bâtir une coalition improbable avec le président des Forces Progressistes du Changement Samba Thiam et les baathistes du Sawab, dont le président Abdesselam Ould Horma. Cette alliance a jusqu’ici résisté, car une partie des négro-africains voyait en Birame une figure capable de les ramener sur le devant de la scène politique, en rapprochant Haratines et négro-africains dans la perspective de constituer une communauté unique, pensée comme un bloc d’opposition face à ce qu’ils désignent sous le terme de Beydane « à peau blanche », assimilés à un chauvinisme dominant.
Toutefois, cette vision apparaît difficilement viable. Comme le souligne l’éminent professeur Abdelwedoud Ould Cheikh, une intégration fondée uniquement sur le critère pigmentaire entre Haratines et négro-mauritaniens se heurte à d’importants obstacles. D’un point de vue culturel, les Haratines partagent peu de choses avec les négro-africains : la langue, en particulier, constitue une barrière fondamentale qui les sépare, tout comme la divergence des intérêts sociaux.
Cette tentative de fusion repose en réalité sur une construction idéologique performative : elle cherche à « faire advenir » une identité commune par un discours militant, mais se heurte au fait que les classifications qu’elle mobilise sont artificielles et ne correspondent pas aux réalités sociales vécues. En d’autres termes, il s’agit d’un projet qui exprime davantage un souhait politique qu’une dynamique enracinée dans les pratiques et les structures sociales effectives.
Birame se lança dans les élections de juin 2024, mais échoua à franchir le cap. Il comprit alors qu’il ne pourrait jamais accéder à la présidence en se limitant à un discours purement identitaire sans rallier ceux qu’il appelle les Beydane. Il adopta dès lors une nouvelle stratégie : se rapprocher de certains beydane et s’entourer d’intellectuels, parmi lesquels quelques professeurs éminents de la diaspora et de l’intérieur du pays.
Il amorça ensuite une série de discours aux accents parfois contradictoires. Dans l’hexagone, loin de la Mauritanie, il affirma que son combat n’était pas dirigé contre les beydane en tant que tels, mais contre un système. Cette inflexion fut mal perçue par les radicaux, pour qui la question demeure celle d’une domination des « blancs » sur les « noirs ».
Le 30 août 2025, à Bruxelles, entouré de cadres d’IRA-Europe, Birame tenta une nouvelle opération de séduction auprès du Parlement européen. Mais l’Europe, désormais liée à la Mauritanie par une convention sur la lutte contre l’immigration illégale, ne l’écoutait plus. Son discours racial, répété à l’envi, sonnait désormais creux.
De Harlem à Nouakchott, une leçon : lorsque la citoyenneté ne prime pas, chacun s’érige en juge de l’identité de l’autre. Birame, héritier paradoxal d’une lutte juste, a transformé l’abolitionnisme en fonds de commerce politique.
Mais la vérité demeure : la Mauritanie appartient à tous ses citoyens, Pulaar, Soninké, Wolof, Maures blancs et noirs. La diversité est richesse, non menace. Tant que ce principe ne s’impose pas, le pays restera prisonnier de débats stériles sur la couleur et l’origine.
Mohamed Echriv Echriv