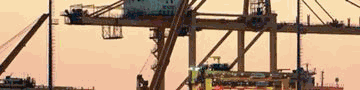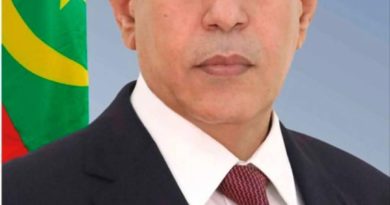Xavier Coppolani, l’architecte de la séparation entre le Maroc, le Sahara et la Mauritanie
Hespress – Depuis de nombreuses années, j’observe un vif intérêt pour la question du conflit du Sahara occidental, souvent présenté comme une opposition entre le Maroc et l’Algérie ou encore entre le Royaume du Maroc et le Front Polisario. Pourtant, à chaque fois que des prétendus spécialistes ou analystes politiques abordent ce sujet, je constate qu’ils passent à côté de l’essentiel : personne ne prend réellement le temps d’expliquer les origines profondes de ce conflit, ni comment nous en sommes arrivés à la situation actuelle.
C’est pourquoi je tiens à exprimer toute ma gratitude à Monsieur @mounirdoli, dont les recherches précieuses dans les archives ont permis de révéler une vérité historique longtemps occultée. Son travail met en lumière des faits fondamentaux que beaucoup ignorent, en particulier sur le rôle déterminant d’un homme méconnu du grand public : Xavier Coppolani.
Xavier Coppolani, natif de Corse, a passé sa vie en Algérie Française, notamment à Constantine. Parfaitement arabophone et converti à l’islam, il était un fin connaisseur des sociétés sahariennes. Sa mission, confiée par la France, était claire : pacifier et asseoir le contrôle sur les vastes territoires encore échappant à l’administration coloniale française, dont l’actuelle Mauritanie, l’ouest du Mali et le Sahara occidental et le Sahara oriental.
C’est lui qui, d’un simple trait de plume, a redessiné la carte de la région. C’est lui qui a introduit pour la première fois l’appellation « Sahara occidental » en scindant arbitrairement l’ancienne « Mauritanie occidentale » en deux entités : la Mauritanie actuelle et ce territoire aujourd’hui disputé. La carte réalisée en 1880 par l’Allemand Oskar Lenz montre pourtant clairement qu’il n’existait alors qu’un seul État dans cette vaste région : l’Empire chérifien marocain. Aucun territoire ne portait le nom de Sahara occidental, de Mauritanie ou de Mali.
En manipulant habilement des rivalités tribales, notamment entre les chefs sahraouis Ahmed Selou et Mohamed Fall, Coppolani réussit à introduire l’armée française sans véritable opposition dans la région. Mais ce subterfuge ne trompa pas tout le monde. D’éminents chefs religieux et tribaux, comme Cheikh Ma El Aïnin, Cheikh Sidiya ou Cheikh Sad Bouh, résistèrent fermement à cette ingérence. En réponse, Coppolani rédigea un rapport dans lequel il évoqua pour la première fois le concept de « Mauritanie occidentale », faisant ainsi allusion à l’ancienne appellation du Maroc dans l’Antiquité : le Royaume de Maurétanie.
Le 27 juin 1900, un tournant décisif eut lieu avec la signature du traité de Paris entre la France et l’Espagne. Ce jour-là, des frontières nouvelles furent tracées sur la base d’intérêts coloniaux. C’est à ce moment précis que le Maroc perdit plus de 80 % de son territoire historique, dont le Sahara occidental. Les lignes rouges, vertes, jaunes et bleues dessinées à l’époque sont à l’origine de la configuration actuelle des frontières en Afrique de l’Ouest. Ce fut, sans doute, le jour le plus funeste de l’histoire territoriale du Maroc. Et pourtant, très peu en parlent.

Observez attentivement cette carte : elle illustre les véritables frontières de l’Empire chérifien du Maroc avant la signature du traité. C’est Xavier Coppolani qui a décidé, d’un simple trait de plume, de redessiner la carte de la région : une ligne rouge a été tracée juste au sud de Sidi Ifni, les zones en bleu représentent la nouvelle Mauritanie, les lignes vertes le Sahara oriental, attribué plus tard à l’Algérie française en 1952 à des fins administratives, et la ligne jaune le Soudan français, aujourd’hui connu sous le nom du Mali, où se trouve la ville de Tombouctou. Pour résumer, ce jour-là, le Maroc a officiellement perdu plus de 80 % de ses territoires historiques — non pas par une guerre, mais par le simple coup de crayon de Xavier Coppolani. Tous ces pays ont été créés sur des terres autrefois marocaines.
L’Espagne prit alors le contrôle du Sahara occidental sans qu’aucune frontière ni traité précis n’en délimite les contours. Ce flou juridique est à l’origine de nombreux débats actuels. Cheikh Ma El Aïnin, nommé gouverneur de la région par Dahir royal, fit de Smara la capitale spirituelle de la résistance. La lutte se poursuit jusqu’à ce que Xavier Coppolani soit abattu d’une balle dans la tête le 12 mai 1905 — un acte qui marque un tournant dans la résistance marocaine. Son corps repose aujourd’hui en Mauritanie, et une petite statue en son honneur subsiste en Corse.
Vous comprenez désormais mieux d’où viennent les appellations « Mauritanie », « Sahara occidental », « Sahara oriental », ou encore « Mali ». Avant leur indépendance, ces entités n’existaient tout simplement pas. Elles sont nées d’un principe juridique imposé par les puissances coloniales : celui de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Cette règle, bien qu’invisible, constitue aujourd’hui le socle sur lequel repose l’ordre territorial en Afrique.
Or, c’est précisément ce qui empêche la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Car si cette souveraineté venait à être reconnue, cela ouvrirait juridiquement la voie à une revendication marocaine sur d’autres territoires perdus pour les mêmes raisons : l’ouest du Mali, l’actuelle Mauritanie, voire une partie de l’Algérie. Ce précédent ferait trembler toute l’Afrique.
Mais il est bon de rappeler que le Maroc, contrairement à ses voisins, existait bien avant la colonisation. Ses frontières historiques sont connues, et la Constitution marocaine de 2011, à son article 42, affirme clairement que le Roi est le garant de l’intégrité territoriale du Royaume dans ses frontières authentiques.
Ainsi, le conflit de 1975, souvent mis en avant, n’est qu’une conséquence d’un processus beaucoup plus ancien, initié en 1900. Ce n’est qu’un épisode, manipulé à l’époque par Kadhafi et Houari Boukharouba, pour tenter de faire tomber la monarchie marocaine. L’enjeu n’est donc pas seulement politique, il est aussi juridique, historique et identitaire.
Merci à celles et ceux qui prendront le temps de lire, de réfléchir, et de partager ce message. Trop de gens ignorent encore cette page fondamentale de notre histoire, souvent absente des manuels scolaires. Il est temps de rétablir les vérités enfouies sous des décennies de silence.

*Président du think tank big décision, expert en géopolitique
Mohammed Komat