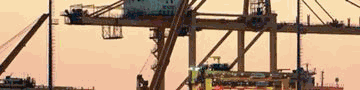Ports d’Afrique de l’Ouest : la bataille logistique passe aussi par la sécurité
Alors que les ports du Golfe de Guinée modernisent à marche forcée leurs installations pour capter davantage de flux, un nouveau facteur de différenciation émerge : la sécurité. Longtemps reléguée à un impératif réglementaire, elle s’impose aujourd’hui comme un levier d’attractivité et encore plus, d’intégration régionale. Un enjeu géo-économique majeur pour la dynamisation des échanges intra-continentaux.
Sécurité portuaire : une nouvelle ligne de fracture
Mais à mesure que les infrastructures s’alignent sur les standards internationaux, un autre levier – moins spectaculaire, mais de plus en plus stratégique – s’impose : la sécurité des flux logistiques.
Pendant longtemps, la sûreté portuaire était considérée comme une ligne réglementaire à cocher : un peu de contrôle d’accès, quelques patrouilles, une conformité formelle aux normes ISPS. Mais dans une région exposée à une combinaison unique de risques – piraterie maritime, trafics illicites, informalité logistique, cybermenaces, pressions sécuritaires dans les hinterlands – cette approche minimale ne suffit plus.
Les chiffres sont éloquents. Abidjan ambitionne de consolider son rôle de hub pour le Mali et le Burkina Faso, avec plus de 30 millions de tonnes traitées chaque année. Lomé, aligné sur les grands circuits maritimes via MSC, dépasse 1,8 million d’EVP. Cotonou, longtemps en retrait, tente une remontée en s’appuyant sur une coopération avec Anvers. Et Kribi, encore jeune, se spécialise dans les flux miniers et les porte-conteneurs de grand gabarit.
Chacun de ces ports développe ses infrastructures. Mais le facteur de différenciation ne se joue plus uniquement sur la longueur des quais ou la rapidité de dédouanement. “Il se déplace – doucement mais sûrement – vers la capacité à garantir un environnement maîtrisé, traçable, résilient”, explique un expert régional en transports et logistiques.
Car les vulnérabilités ne manquent pas : vols de marchandises, conteneurs falsifiés, accès non contrôlés, pratiques informelles, corruption sur les quais. S’ajoutent désormais des enjeux plus récents : cyberattaques sur les systèmes portuaires, instabilité dans les zones de transit, infiltration des réseaux logistiques par des groupes armés ou criminels. Dans certains ports, des cargaisons entières disparaissent ou arrivent altérées. Pour les opérateurs internationaux, cela se traduit mécaniquement par des surcoûts assurantiels, des ruptures de chaîne d’approvisionnement, et une perte de compétitivité sur des marchés tendus.
Face à ces défis croissants, chaque port avance avec ses propres outils. Certains misent sur l’intégration verticale, d’autres sur des partenariats techniques. “La sécurité, comme la logistique, n’a pas de solution unique”, précise le spécialiste.
À Abidjan, les dispositifs ont été renforcés au fil des extensions du port, avec une attention accrue à la conformité ISPS et à la coordination des forces publiques. Lomé, en raison de son statut de hub international de transbordement, conserve une logique d’optimisation douanière et de contrôle aux points critiques. Cotonou, dans le cadre de sa coopération avec le Port d’Anvers, a engagé une réforme progressive de ses flux, avec des efforts notables sur la traçabilité. Kribi, plus récent, bénéficie de standards techniques modernes, mais sa sécurisation reste encore largement appuyée sur des dispositifs militaires et maritimes.
Eugène Berg
Sur les côtes du Golfe de Guinée, la bataille des ports ne se livre plus seulement à coups de portiques géants ou de tirants d’eau impressionnants. D’Abidjan à Kribi, en passant par Lomé, Cotonou ou Douala, les plateformes portuaires de la région modernisent, étendent, automatisent. Depuis une décennie, les milliards investis dans les quais, les dragages et les terminaux reflètent une volonté claire : gagner en capacité, en vitesse, en connectivité régionale.
Et les perspectives sont loin de se limiter aux seules économies nationales. Selon la Banque mondiale, la mise en œuvre progressive de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) pourrait accroître de 81 % les exportations intra-africaines d’ici à 2035, en stimulant les chaînes de valeur régionales et en abaissant les barrières commerciales. Un potentiel qui donne une nouvelle portée aux ambitions portuaires.
Pour accompagner cette dynamique, les investissements ont été massifs. Sur la dernière décennie, au moins 5 à 6 milliards de dollars ont été injectés dans les infrastructures portuaires d’Afrique de l’Ouest. Le seul port de Lekki, au Nigeria, a mobilisé 1,5 milliard de dollars pour sa construction. Le port de Ndayane, au Sénégal, en cours de développement par DP World, représente un projet de 1,2 milliard de dollars sur deux phases. À Abidjan, l’extension du port avec un second terminal à conteneurs a nécessité un financement d’environ 953 millions de dollars, tandis que Lomé Container Terminal (LCT) a bénéficié d’un investissement de près de 370 millions de dollars. À cela s’ajoutent les projets du port de Cotonou, doté d’un plan de modernisation de plus de 685 millions d’euros, et les extensions en cours à Douala, où près de 210 millions d’euros ont été engagés, notamment avec le soutien d’Afreximbank.
Douala, laboratoire d’une approche externalisée
Douala, de son côté, a emprunté une voie moins répandue : celle de faire appel à une expertise externe pour repenser sa stratégie de sûreté. En 2019, le Port autonome de Douala (PAD) a confié la mise en œuvre du programme Douala Port Security (DPS) à PortSec SA, une entreprise camerounaise spécialisée dans la sécurisation des infrastructures critiques. Un contrat stratégique qui, selon les données officielles, s’inscrit dans un ensemble d’investissements de plus de 100 milliards FCFA (environ 152 millions d’euros) réalisés depuis 2020 pour moderniser l’ensemble du port — manutention, dragage, sécurité, connectivité.
À Douala, le choix d’un partenaire externe pour piloter la sécurisation portuaire ne s’est pas imposé par idéologie, mais par nécessité. En 2019, au moment où le port reprend la main sur son terminal à conteneurs, les vulnérabilités sont nombreuses : taux de pertes sur certaines cargaisons sensibles (notamment le bois) atteignant jusqu’à 20 %, vols récurrents sur les quais, accès non maîtrisés, et une traçabilité logistique encore lacunaire. Le port peinait à convaincre les chargeurs internationaux et voit son image se dégrader dans un contexte de concurrence régionale croissante.
C’est dans ce cadre que le PAD a confié la mise en œuvre du programme Douala Port Security (DPS) à PortSec SA, société spécialisée dans la sécurisation des infrastructures critiques. Le partenariat repose sur un encadrement contractuel clair, avec des objectifs de résultats suivis par l’autorité portuaire, indiquent les nouvelles autorités du port, qui rappellent que 70 % des marchandises importées au Cameroun transitent par Douala, et qu’environ 35 % de son trafic est destiné aux pays enclavés de la sous-région, notamment le Tchad et la Centrafrique. Résultat : entre 2019 et 2023, les pertes et vols de marchandises ont reculé de 35 %, selon les données internes. La phase 3 du programme DPS, engagée en mars 2025, poursuit cette logique de montée en gamme. Elle prévoit l’introduction de drones de surveillance, de clôtures intelligentes, de scanners à haute précision, ainsi que le recrutement de 200 agents de sécurité supplémentaires.
Cette dynamique sécuritaire s’est accompagnée d’un redressement financier plus global. Le chiffre d’affaires du port a doublé entre 2019 et 2023, atteignant 119,6 milliards FCFA. Le bénéfice net a triplé, pour atteindre 14,4 milliards FCFA, tandis que les redevances reversées à l’État sont passées de 4,5 à près de 20 milliards FCFA. “Le volet sécuritaire n’explique pas tout, mais le partenariat PAD/PortSec a de facto contribué à rétablir la confiance d’opérateurs jusque-là hésitants” explique un analyste camerounais.
Monter en gamme géo-économique
Pour gérer les flux stratégiques qui transitent par le corridor Douala–Bangui–N’Djamena, la sécurisation s’étend au-delà des quais : escortes ponctuelles de convois, coopération entre États riverains dans le cadre de l’architecture de Yaoundé, et exercices conjoints de surveillance maritime, notamment avec la France. Douala, autrefois perçu comme un maillon vulnérable, entend se positionner comme un pivot logistique régional capable d’absorber la pression sécuritaire sans casser la chaîne de circulation des biens.
Le modèle du PAD — une sécurisation déléguée, encadrée et techniquement spécialisée — reste encore marginal dans la région, où la fonction est généralement assurée en régie ou confiée aux forces de sécurité publiques. Il n’échappe pas à la critique, notamment sur les questions de souveraineté et de dépendance technique. Mais dans un environnement où les chaînes d’approvisionnement sont exposées à de multiples perturbations, où les marges sur le fret se contractent, et où les compagnies d’assurance internationales ajustent désormais leurs primes en fonction du niveau de sûreté des plateformes, la sécurité n’est plus un simple impératif réglementaire : elle est devenue un facteur de compétitivité à part entière. Surtout, à l’heure où le PAD ambitionne de porter sa capacité à 1 million d’EVP d’ici 2026 — contre 380 000 EVP traités en 2023 —, l’enjeu prend une dimension stratégique.
Pour Douala comme pour les autres ports de la région, la sécurité est un vecteur de croissance et de développement, en témoigne les zones industrielles qui se multiplient dans leur sillage : GDIZ au port de Cotonou, PK24 à Abidjan ou Dibamba à proximité du PAD. Mais ces investissements ne produiront pleinement leurs effets que dans un environnement logistique stabilisé, où les flux sont prévisibles, les incidents réduits, et la chaîne d’exécution crédible aux yeux des opérateurs. Autant de conditions que la sécurisation permet de rendre atteignables, à condition qu’elle soit pensée comme une composante structurante, et non comme un simple dispositif de contrôle.
Source : Journal de l’Économie