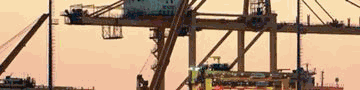Mauritanie, rares sont les ministres qui s’attaquent de front à des bastions d’intérêts économiques
Dans l’histoire politique récente de la Mauritanie, rares sont les ministres qui s’attaquent de front à des bastions d’intérêts économiques aussi enracinés que le secteur pharmaceutique. Plus rares encore sont ceux qui en sortent indemnes. La réforme annoncée par M. Abdellah Ould Weddih s’inscrit dans cette tradition des grandes tentatives de réappropriation de la souveraineté publique — mais elle convoque aussi un spectre : celui de son prédécesseur Nadhirou Ould Hamed, dont le volontarisme s’est brisé contre les digues invisibles d’un lobby tentaculaire.
La question n’est donc pas seulement de savoir si les mesures sont bien conçues — elles le sont, sur le papier — mais si le ministre dispose des leviers politiques, institutionnels, sécuritaires et médiatiques pour tenir dans la durée. Car la réforme pharmaceutique n’est pas une simple affaire de logistique ou de conformité réglementaire : elle est une remise en cause directe de circuits informels puissants, aux ramifications qui vont bien au-delà du secteur sanitaire.
Rappelons-le : Nadhirou avait osé imposer la centralisation des importations, tenté de nettoyer la nomenclature des produits, et lancé les premières opérations contre les « pharmacies au sol » et les dépôts illégaux. Il s’en est suivi une guerre souterraine. Grèves discrètes, sabotages administratifs, campagnes de diffamation dans la presse parallèle, et pressions politiques dans les cercles hauts. Le ministre a tenu… jusqu’à ce que le système, dans un geste de préservation cynique, ne l’éjecte.
La même mécanique pourrait se réactiver contre Ould Weddih. D’autant que ce dernier, en allant inspecter le port et les entrepôts, donne un signal clair : il ne réforme pas depuis son bureau, il entre dans les circuits, il touche au cœur économique du pouvoir informel. Cela, dans un pays où la frontière entre État et affairisme est poreuse, n’est jamais sans conséquence.
La réforme du médicament ne sera pas un chemin linéaire. Les intérêts qu’elle bouscule savent se défendre. Dans les couloirs du pouvoir, dans la presse de connivence, dans les réseaux administratifs et parfois même au sein du ministère, les leviers de sabotage sont multiples : lenteurs, omissions, calomnies savamment orchestrées. Le ministre devra donc affronter, en plus des résistances visibles, une machine d’usure diffuse et méthodique, dont le propre est de tuer sans éclat.
Un autre facteur de fragilité réside dans la gestion de la communication. Le lobby, s’il ne peut faire tomber la réforme par l’argument, cherchera à construire contre le ministre une image d’arrogance ou de duplicité, insinuant des soupçons, fabriquant des controverses, détournant l’attention de l’essentiel : la santé publique. Ce jeu de l’ombre, Nadhirou l’a connu. Ould Weddih y entre à son tour.
Résister, ici, ne signifie pas simplement survivre politiquement, mais incarner une rupture, tenir le cap dans la tempête, et inscrire l’autorité publique dans la durée. Car si cette réforme échoue, ce ne sera pas uniquement le ministre qui tombera : ce sera le signal, une fois de plus, que l’État n’est pas plus fort que les réseaux qu’il prétend réguler. Et ce constat, silencieux mais ravageur, pèsera longtemps sur les consciences.
Mohamed Echriv Echriv