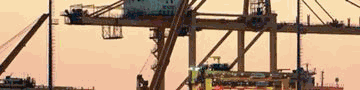La vraie question n’est pas : « qui sommes-nous ? » mais « que voulons-nous devenir ensemble ? »
Et si, demain, un membre de la communauté maure lançait un appel aux descendants d’esclaves soninké (komos lemmou) ou peulhs (maccube), les invitant à se constituer chacun en une nouvelle « ethnie » distincte, quelle serait la réaction ?
La question n’est pas une provocation. Elle est un scalpel anthropologique qui dissèque la manière dont nos sociétés transforment la mémoire de la servitude en argument de structuration identitaire.
La mémoire, lorsqu’elle se transforme en ethnie, court le risque de s’autonomiser du vécu pour s’ériger en mythe séparateur. C’est alors moins l’injustice que l’on combat que la fragmentation que l’on institue.
Accepterions-nous, demain, que chaque mémoire douloureuse se transforme en une ethnie nouvelle ?
Un jour les descendants d’esclaves soninké, le lendemain ceux des peulhs, et pourquoi pas après-demain ceux des wolofs ?
L’ethnologie comparée montre que, dès lors qu’une logique de segmentation est entamée, elle n’a pas de fin : chaque blessure, chaque stigmate, chaque humiliation devient principe de différenciation. La justice initialement invoquée se mue alors en multiplication de frontières, où l’injustice ne disparaît pas mais se reproduit à l’infini.
Poussons plus loin encore l’hypothèse : et si, plutôt que d’isoler chaque mémoire, on décidait de fédérer tous les affranchis — qu’ils soient issus des maures, des peulhs, ou des soninké — dans une nouvelle ethnie composite, aux trois langues (hassaniya, pulaar, soninké), à la mémoire commune de la servitude, et à la volonté partagée de dignité ?
Une telle « ethnie des affranchis » n’existerait que comme ironie, car elle montrerait l’absurdité d’une logique qui substitue des catégories nouvelles à celles mêmes qu’elle prétend abolir. On croirait briser les chaînes, et l’on ne ferait que les réarranger dans une nouvelle orfèvrerie classificatoire.
La vraie question n’est pas : « qui sommes-nous ? » mais « que voulons-nous devenir ensemble ? »
La reconnaissance des douleurs est indispensable, mais leur instrumentalisation en frontières identitaires est une impasse. Car si chaque cicatrice devient une « ethnie », alors nous ne construirons jamais un corps social, mais seulement un archipel de blessures.
Laissons-nous plutôt nous réunir pour fonder un État juste,, combattre ensemble les injustices des couches défavorisées et réclamer l’égalité des chances. La population de la Mauritanie n’atteint même pas celle d’un seul quartier de Hong Kong. Il est donc bien plus facile de nous réunir que de nous diviser.
Mohamed Echriv Echriv