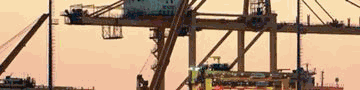La Mauritanie, hier comme aujourd’hui, n’est pas un collage fragile d’ethnies : elle est une symphonie historique
Nos ancêtres ont façonné un espace où des communautés diverses – maures, peuls, soninkés, wolofs, bambaras – se sont rencontrées non pas comme des antagonistes, mais comme des compléments dans une vaste composition civilisationnelle.
L’histoire vestimentaire en dit long : le boubou, aujourd’hui porté indistinctement par maures et négro-africains, est le fruit d’une circulation de formes. Jadis, les maures portaient le caftan, marque d’un legs andalou et maghrébin, mais au fil du temps, l’influence des voisins peuls et soninkés s’est matérialisée dans l’adoption du boubou ample. Ce vêtement, devint la seconde peau d’une identité partagée. Ainsi, dans le tissu, se trame l’histoire de la fraternité.
De même, la musique révèle la fusion. Les griots maures, souvent eux-mêmes descendants de dynasties, ont repris les airs peuls, soninkés, wolofs et bambaras. La tidinit – sœur maure du luth mandingue – vibre des mêmes cordes que le ngoni. Les mélodies du suudu pathé se prolongent dans les ashwâr de l’azawan. Chaque note n’est que le prolongement d’une parenté cachée. Les rencontres mélodiques ne sont que la mise en musique de retrouvailles entre cousins.
Les Almoravides, dit-on, lorsqu’ils entrèrent à Sijilmassa, brisèrent les instruments de musique qu’ils jugeaient frivoles. Mais les communautés, ont résisté pour réaffirmer la force de la joie partagée.
Autour du feu de camp ou du foyer urbain, le thé à trois verts a inscrit la convivialité dans un rituel immuable, devenu un symbole national.
De même, l’art culinaire témoigne d’une osmose gustative. Le couscous, s’est marié avec le lakh à base de mil, avec le mbakhal parfumé aux oignons, ou avec les sauces riches en gombo. Dans la marmite, comme dans l’Histoire, les ingrédients se mélangent sans se nier.
L’habitat, lui aussi, raconte cette symbiose : la tente, symbole du nomadisme, se complète par la case ronde ou la maison en banco. Ces formes, en apparence divergentes, traduisent toutes une même philosophie : adapter l’architecture à l’espace, au climat, et aux besoins de la communauté. Là encore, la diversité est une variation d’un même thème.
La caravane fut la grande école de la coopération. Les marchands conduisaient les dromadaires chargés de sel, du mil, et des tissus. L’échange ne fut pas seulement économique : il fut civilisationnel.
Au cœur de cette symbiose se trouve l’Islam malikite, qui a aplani les différences et institué un horizon commun. Là où d’autres sociétés musulmanes se sont fracturées entre sunnites et chiites, le malikisme a offert à la Mauritanie une unité doctrinale.
Il est vrai que, par intervalles, des voix discordantes ont tenté de fissurer cette unité. Ces figures erratiques, ne portent pas de cause véritable : ils ne cherchent qu’à instrumentaliser la souffrance pour bâtir des murs là où l’Histoire a bâti des ponts. Ils crient à l’injustice non pour la réparer, mais pour désigner des coupables collectifs, confondant les fautes des individus avec l’âme des communautés.
Or, il faut distinguer. La lutte contre l’injustice est juste et nécessaire. Mais lorsqu’elle se mue en accusation raciale globale, elle trahit sa propre légitimité. Toute communauté a connu, dans son sein même, des hiérarchies, des exclusions, des injustices. Nul groupe ne saurait porter seul la responsabilité de l’Histoire.
De même, malgré les tentatives modernes de semer la discorde – financements extérieurs, discours idéologiques, radicalismes importés – l’unité a résisté. Car chaque communauté sait qu’elle a versé son sang pour l’intégrité du pays et versé son encre pour sa pacification.
L’adage hassanien le dit : « Celui qui partage un bol avec toi, si tu le renverses, vous perdez tous. » De même, les communautés de Mauritanie sont comme l’œil : le blanc et le noir n’y sont pas rivaux mais indissociables, chacun donnant sens à l’autre.
La Mauritanie, hier comme aujourd’hui, n’est pas un collage fragile d’ethnies : elle est une symphonie historique, où chaque peuple joue sa partition. Ceux qui tentent d’y introduire la cacophonie de la division seront toujours déjoués, car le désert a sa propre sagesse : il enseigne la solidarité comme condition de survie.
Mohamed Echriv Echriv