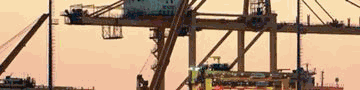LA LEÇON QUE LA MAURITANIE ENSEIGNE À SES VOISINS DE L’AES
Il y a dans le silence mauritanien une leçon que le vacarme AESien refuse d’entendre. Tandis que les juntes militaires de Bamako, Ouagadougou et Niamey multiplient les discours enflammés sur la « souveraineté retrouvée » et la « rupture historique », la Mauritanie, elle, construit la sienne depuis des années sans tambours, sans trompettes, sans ennemis désignés. Juste des résultats : zéro attaque terroriste majeure depuis plus d’une décennie dans un Sahel qui brûle de toutes parts.
Cette exception n’est pas un miracle. C’est un choix politique.
Les militaires mauritaniens ont compris avant leurs homologues ce qu’est véritablement le Sahel : pas un territoire vide à quadriller par la force brute, mais un espace social complexe où les tribus, les trafics et les allégeances se superposent depuis des siècles.
Au lieu d’envoyer des colonnes blindées dans des opérations spectaculaires et inefficaces, Nouakchott a déployé des bases avancées autonomes, confiées à des officiers qui connaissent les codes locaux, qui parlent les langues, qui comprennent les dynamiques tribales. Pas d’improvisation martiale, pas d’arrogance technologique : une présence humaine, enracinée, patiente.
Cette approche a permis de couper la route au jihadisme avant qu’il ne s’enracine. Pendant que d’autres armées transformaient leurs propres populations en ennemis potentiels, la Mauritanie investissait dans l’intelligence territoriale.
Car le tout militaire n’est jamais venu à bout du terrorisme et d’ailleurs les armées suréquipées des États-Unis et de la Russie n’ont-elles pas échoué en Afghanistan. La Mauritanie est tout aussi vaste que le Mali mais elle a su combattre le terrorisme sur son territoire sans faire appel à des mercenaires russes ou turcs et sans investir dans des blindés et des drones. Barkhane, Minusma, …aucune force internationale n’a été déployée en Mauritanie pour lutter contre les terroristes.
Là où le Mali, le Niger et le Burkina ont choisi la brutalité militaire comme réponse exclusive, la Mauritanie a osé l’impensable : dialoguer avec l’idéologie jihadiste sur son propre terrain, le RELIGIEUX.
Des imams formés ont rencontré des combattants prisonniers pour déconstruire, texte coranique à l’appui, la légitimité théologique de leur combat. Pas de torture, pas de disparitions : un débat d’idées mené avec les armes de la foi.
Le résultat ? Des dizaines de repentis réintégrés, un discours religieux national cohérent, et surtout, une victoire symbolique capitale : le jihadisme a perdu son vernis sacré là où il continue de séduire ailleurs. La Mauritanie a compris que les balles tuent les hommes, mais que seules les idées tuent les idéologies.
Pendant que les casernes sahéliennes se transformaient en palais présidentiels, l’armée mauritanienne a fait un choix devenu rarissime dans la région : rester dans son rôle.
Certes, la Mauritanie a connu ses propres coups d’État, le dernier en 2008. Mais depuis, une discipline institutionnelle s’est imposée. Les officiers mauritaniens n’ont pas confondu le pouvoir avec le spectacle. Ils ont compris que la légitimité militaire ne se proclame pas devant des foules en liesse, mais se construit dans les casernes, dans la discipline, dans la fidélité à une mission claire : protéger le territoire, pas gouverner par la force.
Cette sobriété institutionnelle a préservé la Mauritanie de la spirale des putschs à répétition qui ravage ses voisins. Un État ne peut être stable quand son armée change de rôle tous les cinq ans.
La Mauritanie n’a pas crié contre la France. Elle n’a pas juré fidélité éternelle à Moscou. Elle n’a pas fait de chaque accord de coopération un acte de foi idéologique ou une trahison à dénoncer.
Pendant que ses voisins transforment la diplomatie en théâtre révolutionnaire, Nouakchott pratique le non-alignement fonctionnel : coopérer avec qui sert les intérêts nationaux, rester neutre quand nécessaire, négocier sans s’humilier.
Cette approche n’a rien de glorieux sur le plan médiatique. Elle ne produit pas de clips viraux ni de discours incendiaires. Mais elle garantit ce que les postures ne garantissent jamais : la survie de l’État, pas la gloire éphémère d’un chef.
Dans le Sahel d’aujourd’hui, certains ont confondu la souveraineté avec l’isolement, la fierté avec la fermeture, la résistance avec l’aveuglement stratégique.
La souveraineté n’est pas de claquer les portes. Elle n’est pas de désigner un ennemi extérieur pour masquer les échecs intérieurs. Elle n’est pas un discours, encore moins un slogan scandé dans les stades.
La souveraineté, c’est la capacité de décider pour soi, et cette capacité ne s’acquiert que par la compétence, la discipline, la connaissance du réel.
Pendant que les autres chantaient « nous n’avons besoin de personne », la Mauritanie formait ses imams, ses officiers, ses agents de renseignement. Pendant que les autres insultaient les chancelleries, elle négociait des partenariats utiles. Pendant que les autres s’enfermaient dans la victimisation, elle consolidait son État.
Soyons honnêtes : la Mauritanie n’est pas un paradis. Elle reste fragile économiquement, dépendante de ressources extractives, confrontée à une pauvreté endémique et à des défis démocratiques réels. La question de l’esclavage et de ses séquelles demeure une plaie ouverte.
Sa géographie l’aide aussi : une façade atlantique, une position moins centrale dans les flux jihadistes que le Mali ou le Burkina. Le succès mauritanien n’est pas que stratégique, il est aussi géographique.
Mais ces nuances n’invalident pas la leçon : dans des conditions comparables, voire pires, la Mauritanie a fait des choix différents et elle tient debout.
Le Sahel brûle, et la Mauritanie reste debout. Ce n’est pas un hasard, c’est un système.
Un système fondé sur l’intelligence contre l’orgueil, la patience contre le populisme, le travail contre le vacarme.
Si la vraie révolution sahélienne devait venir, elle ne viendrait peut-être pas des discours enflammés des capitales en effervescence, mais du silence efficace de Nouakchott.
Parce qu’au fond, la souveraineté la plus solide est celle qui n’a pas besoin de crier pour exister.
Sambou Sissoko